|
|
|
 |

L'eau
circule en permanence dans l'atmosphère sur la terre et sous
la terre,
entraînée dans un cycle sans fin. Sous l'effet de
la chaleur du soleil,
l'eau des mers, des fleuves et des lacs s'évapore et devient
de la
vapeur d'eau qui forme les nuages.
Les nuages sont poussés par le
vent. Lorsqu'ils traversent des régions froides, la vapeur
d'eau se
condense. Elle retombe sur le sol, sous forme de pluie, de neige ou de
grêle.
L'eau ainsi retombée ruisselle sur le sol ou s'infiltre dans
le sous-sol. Elle vient grossir les fleuves, qui eux-mêmes
retournent à
1a mer et le cycle recommence. C'est le cycle de l'eau.
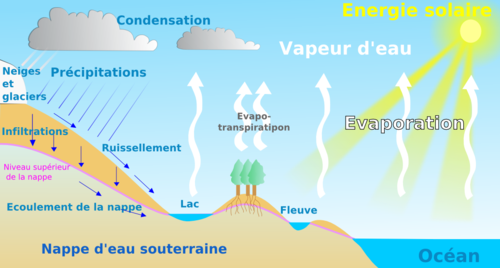
|
La
dynamique du cycle de l’eau
En moyenne sur l’année et sur l’ensemble
du globe terrestre, 65% des précipitations qui arrivent
à terre s’évaporent, 24% ruissellent et
11% s’infiltrent.
Des échanges d’eau se produisent
également entre l’hydrosphère et le
manteau terrestre. Par ailleurs, dans la haute atmosphère,
des molécules d’eau sont constamment
décomposées par les rayons ultraviolets solaires
et l’hydrogène ainsi créé,
trop léger pour être retenu par la
gravité, s’échappe dans
l’univers. Cependant, il semblerait que ces
phénomènes restent suffisamment
négligeables pour que globalement la quantité
totale d’eau dans l’hydrosphère reste
constante : l’analyse des sédiments marins a en
particulier révélé que le volume des
eaux océaniques avait très peu varié
depuis un milliard d’années. On peut donc
considérer que le cycle de l’eau est stationnaire
c’est à dire que toute perte d’eau par
l’une ou l’autre de ses parties,
atmosphérique ou terrestre, est compensée par un
gain d’eau par l’autre partie.
Les réservoirs
de l'eau
Il est dificile de
chiffrer le volume total des eaux terrestres.
Les
seules quantités d’eau qu’il est
aujourd’hui possible d’estimer sont celles
contenues dans les quatre grands réservoirs de
l’hydrosphère, que sont les mers et
océans, les eaux continentales (superficielles et
souterraines), l’atmosphère et la
biosphère. Les volumes les plus difficiles à
évaluer sont ceux des eaux souterraines de la
croûte terrestre, dont les estimations varient en fonction de
l’épaisseur de croûte qu’ils
considèrent.
Aucune
estimation fiable n’est en revanche disponible pour
l’eau contenue dans le manteau terrestre.
Les
stocks sont les volumes d’eau présents
à un instant donné dans un réservoir
donné. Ils donnent en quelque sorte une image
instantanée des volumes d’eau disponibles.
Les
stocks des différents réservoirs terrestres sont
donnés dans le tableau ci-dessous
(d’après L’eau, Ghislain de Marsily,
Dominos Flammarion, 1995). Les volumes sont exprimés en
kilomètres cubes. Un kilomètre cube est le volume
d’un cube de 1 kilomètre de
côté, c’est-à-dire
qu’il équivaut à mille milliards de
litres.
|
Réservoirs
|
Volume km³
|
Pourcentage
|
|
Océans
|
1 370 000 000
|
97,25
|
|
Calottes glaciaires & glaciers
|
29 000 000
|
2,05
|
|
Eau souterraine
|
9 500 000
|
0,68
|
|
Lacs
|
125000
|
0,01
|
|
Humidité des sols
|
65000
|
0,005
|
|
Atmosphère
|
13000
|
0,001
|
|
Fleuves et rivières
|
1700
|
0,0001
|
|
Biosphère
|
600
|
0,00004
|
Au final, la plus grande part de cette énorme
quantité d’eau provient des océans qui
constituent le réservoir le plus important de la
planète mais dont les eaux sont salées.
Les eaux douces de la planète, c’est à
dire celles dont la salinité est inférieure
à 3 grammes par litre, ne représentent que 3% en
volume de toute l’eau de l’hydrosphère
et encore toute cette eau n’est-elle pas disponible, la
majeure partie étant gelée aux pôles.
Le volume des eaux douces directement utilisables est finalement
d’environ 9 millions de kilomètres cubes, dont la
plus grande part consiste en eaux souterraines.
En conséquence, malgré les impressionnantes
quantités d’eau présentes sur notre
planète, nous ne pouvons disposer de fait pour notre
consommation que d’une part infime de toute cette eau. Mais
il ne faut pas oublier que l’eau circule en permanence entre
les différents réservoirs : ainsi, même
si les stocks sont limités, certains sont en permanence
renouvelés.
Source:
CNRS
|
 |



